XVIIIe siècle
-
Cette étude met en évidence l’importance de l’incarcération dans la formation du roman moderne (XVIIe-XVIIIe siècles). Le thème prédominant (crainte d’emprisonnement, description de l’univers des geôles) est le reflet et le symptôme d’inquiétudes d’un genre en plein essor, obsédé par le risque de censure mais dynamisé par des tours d’énonciation inédits et par la passion de l’affranchissement des contraintes. Héritant de Socrate ou de saint Paul (la prison, épreuve de vérité), les picaros d’Alemán, Quevedo, Sorel, Cyrano, Lesage, Prévost, Voltaire ou Diderot offrent des caricatures burlesques oscillant entre mobilité et fixité. Par des lectures astucieuses on redécouvre ces romans majeurs sous un éclairage radicalement nouveau – à l’ombre d’une Bastille encore inamovible.
-
Zélé partisan de la Paix perpétuelle, comme il s’est lui-même défini, Jean-Bénédict Humbert (1749-1819) est une figure de la Révolution genevoise. Il s’est efforcé à la réalisation pragmatique de thèses rousseauistes préconisant un retour à l’état de nature et défendant la simplicité des mœurs. En ajoutant à Rousseau, son modèle initial, des personnalités comme William Penn et Benjamin Franklin, il a appelé également à l’imitation des pères fondateurs des Etats-Unis. Défenseur, tout au long de son existence, d’un projet égalitaire, il a recommandé la répartition juste du territoire, un mode rationnel de vie rurale, un modèle d’autosubsistance, et, comme corollaire de cette refonte économique, la réforme constante des mœurs.
-
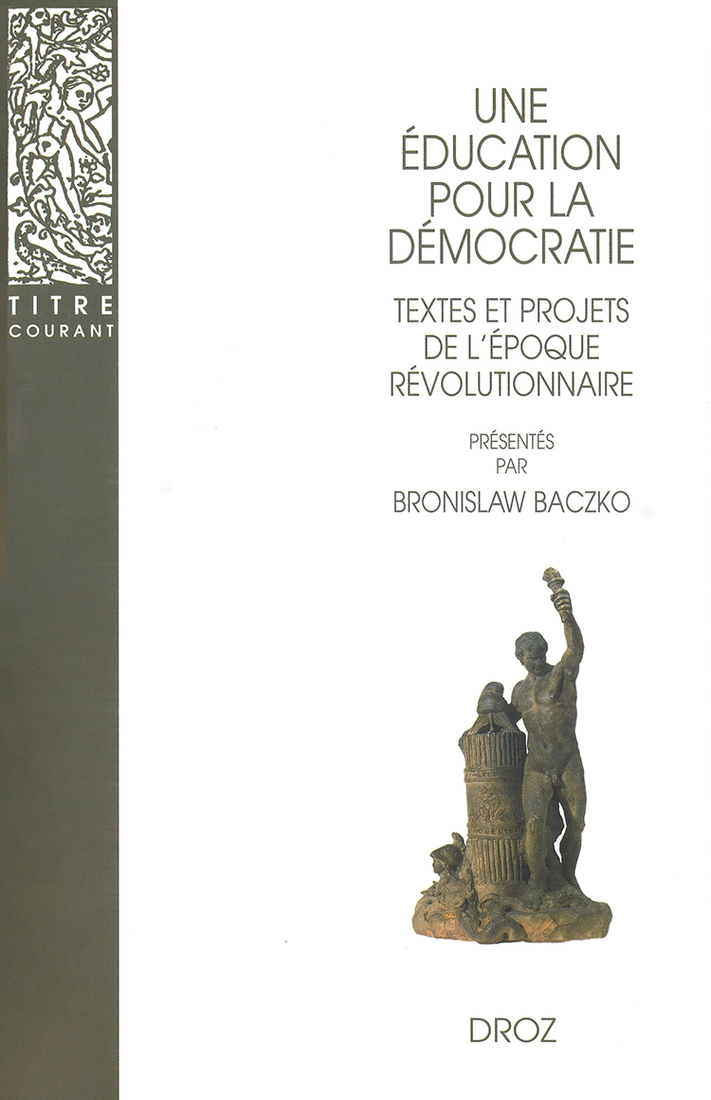
Il revient à la Révolution de façonner un peuple nouveau, le souverain digne de la Cité qu’elle annonce: dès ses débuts la Révolution est investie d’une vocation pédagogique. Tout est à repenser et à inventer: les objectifs et les institutions pédagogiques, un nouveau système d’instruction et d’éducation, les méthodes de formation accélérée de nouveaux enseignants. Un débat passionnant et passionné s’installe au cœur même du discours politique révolutionnaire. Il ne porte pas seulement sur les modèles de l’école pour la Révolution mais a comme objet et enjeu les rapports entre culture et pouvoir, liberté et égalité, tradition et innovation, libéralisme et étatisme, religion et laïcité, dans une société démocratique à inventer. Ce volume réunit les textes les plus importants qui ont marqué ce grand débat et qui ont orienté les expériences pédagogiques de la période révolutionnaire: projets et discours de Mirabeau, Talleyrand, Condorcet, Romme, Lepeletier, Robespierre, Saint-Just, Daunou, Barère, Lakanal, etc.
-
-

Le dénouement de la guerre d’indépendance américaine fit monter l’intérêt que la France portait à la nouvelle république et suscita la publication d’une multitude de travaux. La guerre que se livrèrent l’Angleterre et la France prit bientôt fin. Lassés par ses efforts, la France se trouvait chargée de nouvelles dettes. A Genève, le conflit politique atteignit une telle intensité que la guerre civile sembla inévitable. Elle fut évitée de justesse par la ferme intervention de la France, de la Sardaigne et du canton de Berne. Pendant ce temps, en Autriche, Joseph II modifia sa politique religieuse en proclamant un édit de tolérance, la liberté du culte, confisqua des propriétés ecclésiales et ferma des établissements religieux qu’il jugeait superflus. Rencontrant Pie VI, venu à Vienne, il resta inflexible. Quoique l’intérêt suscité par ces différents mouvements révolutionnaires fût grand, il ne surpassa pas l’enthousiasme qui accueillit le lancement des ballons de Montgolfier en 1783. D’une façon moins spectaculaire, d’autres savants contribuaient alors aux progrès scientifiques, notamment Buffon, Lacépède et Lavoisier. Deux œuvres littéraires remportèrent, lorsqu’elles parurent en 1782, un succès considérable qui ne s’est pas démenti depuis: Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos et les Confessions de Rousseau. Les idées que Voltaire et Rousseau avaient défendues trouvaient une application dans les ouvrages d’écrivains aussi divers que La Harpe, Mirabeau, Marmontel, Mercier et Rétif de La Bretonne. Toutefois, la condamnation de l’injustice, l’idée dominante de l’œuvre de Voltaire et de Rousseau, trouve sa plus puissante expression dans les Mémoires sur la Bastille (1783) de Linguet.
-

Il est maintenant établi que les différents ouvrages de Robert Challe ont amené à redéfinir les limites des genres littéraires français au XVIIIe siècle. Ainsi, le genre romanesque s’ouvre désormais avec les Illustres Françaises, et celui des journaux intimes ou des confessions avec le Journal de voyage aux Indes, de Robert Challe. Enfin, le siècle de la “philosophie” a trouvé une expression aussi précoce que frappante avec les Difficultés sur la religion proposées au père Malebranche. Mais s’il n’est pas une thèse de cet ouvrage qui ne se retrouve plus tard chez Voltaire, il est aussi le seul, dans la littérature “clandestine”, à retracer l’itinéraire biographique et spirituel qui a conduit son auteur d’un catholicisme dévot à un rationalisme encore marqué par ses origines religieuses. C’est une des nouveautés de la présente édition que de dégager ce déisme quasi-évangélique des falsifications qui en avaient fait, sous le titre menteur du “Militaire philosophe”, un bréviaire du matérialisme de Naigeon. La présente édition des Difficultés sur la religion d’après un manuscrit enfin fidèle et complet couronne la publication dans les Textes Littéraires Français (voir les n° 400, 438, 466 et 494) des œuvres du digne interlocuteur de Nicolas Malebranche.
-
-

Les années 1712-1714, les dernières de cette Correpondance ont un accent tragique et apaisé. Fénelon voit ses espoirs brisés par la disparition de ses meilleurs soutiens : avec la mort du Dauphin, son ancien élève, disparaissent le rêve fénelonien d’un renouveau du royaume et toute perspective de jouer un rôle dans une politique inspirée par l’esprit du Télémaque ; avec celle des ducs de Chevreuse et de Beauvillier, Fénelon perd la possibilité de se faire entendre au Conseil du roi. S’il peut, grâce au retour de la paix, se consacrer à ses tâches pastorales et au projet de construction de son séminaire, son souci majeur est de contrer, au delà même de son diocèse, l’influence janséniste. Ses interventions à Versailles et à Rome contribuent certes à la publication de la bulle Unigenitus, mais il faut ensuite faire recevoir la bulle par les évêques de France malgré les atermoiements de l’archevêque de Paris, Noailles, et c’est avant d’avoir pu triompher de ce dernier dans un concile national que la mort le frappe.
-
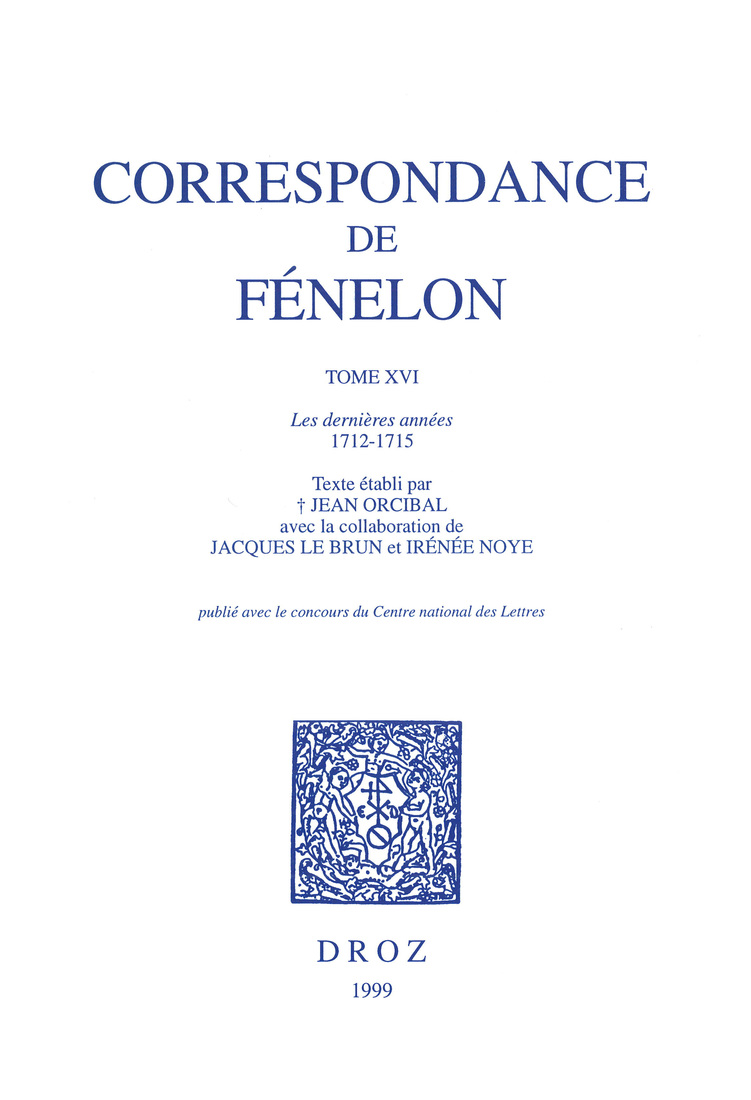
Les années 1712-1714, les dernières de cette Correpondance ont un accent tragique et apaisé. Fénelon voit ses espoirs brisés par la disparition de ses meilleurs soutiens : avec la mort du Dauphin, son ancien élève, disparaissent le rêve fénelonien d’un renouveau du royaume et toute perspective de jouer un rôle dans une politique inspirée par l’esprit du Télémaque ; avec celle des ducs de Chevreuse et de Beauvillier, Fénelon perd la possibilité de se faire entendre au Conseil du roi. S’il peut, grâce au retour de la paix, se consacrer à ses tâches pastorales et au projet de construction de son séminaire, son souci majeur est de contrer, au delà même de son diocèse, l’influence janséniste. Ses interventions à Versailles et à Rome contribuent certes à la publication de la bulle Unigenitus, mais il faut ensuite faire recevoir la bulle par les évêques de France malgré les atermoiements de l’archevêque de Paris, Noailles, et c’est avant d’avoir pu triompher de ce dernier dans un concile national que la mort le frappe.
-
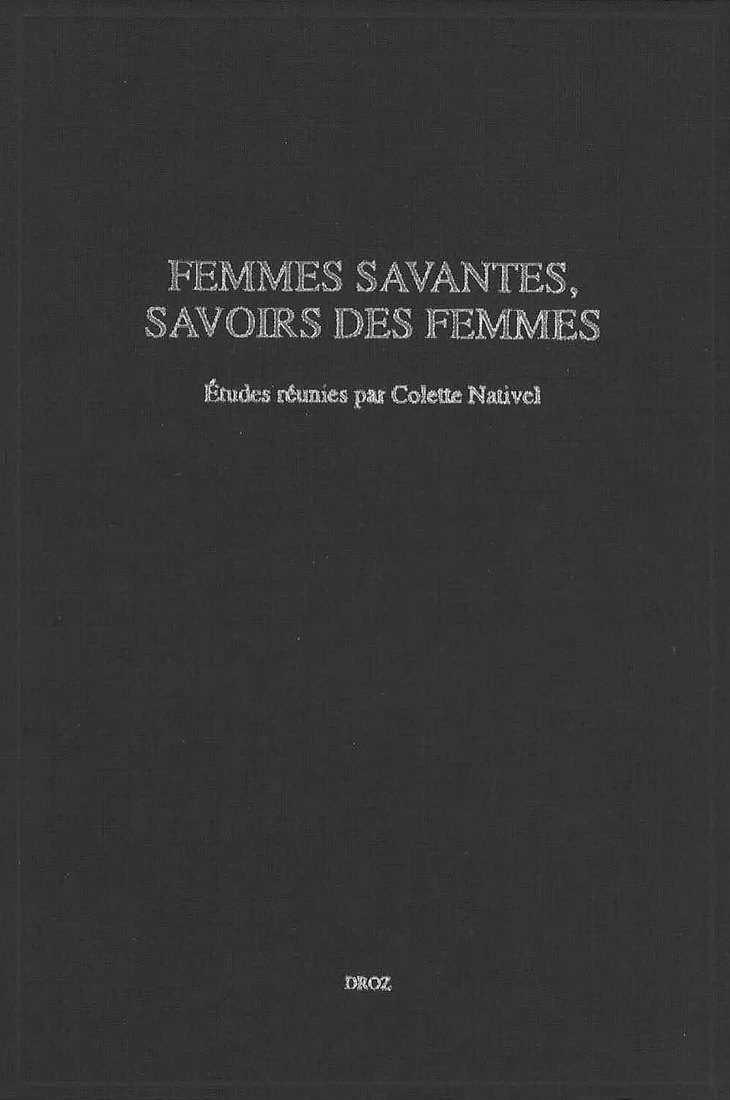
Ce colloque, qui s’est tenu au Centre Culturel des Fontaines en septembre 1995, envisage différents aspects de l’évolution du savoir féminin à l’époque moderne, sa nature, ses contestations éventuelles. La première partie vise à ancrer la réflexion dans la réalité, souvent complexe de la période. Elle étudie les cadres institutionnels qui définissent l’activité féminine et la diversité des savoirs féminins. La seconde partie aborde l’éloge ou la contestation de ce savoir, sa place dans l’histoire des moeurs, des institutions et des idées. Enfin, sept portraits exemplaires de femmes savantes viennent compléter ce panorama.
REALITES/SAVOIRS: - Christian Biet. Quand la veuve contre -attaque : droit et fiction littéraire sous l'ancien régime. - Bruno Neveu. Doctrix et Magistra. - Colette Winn. Les femmes et la rhétorique de combat : argumentation et (auto) référentialité. - Nathalie Grande. L'instruction primaire des romancières. - Sabine Juratic. Marchandes ou savantes? Les veuves des libraires parisiens sous le règne de louis XIV. - Pierre Maréchaux. Savoir des doigts, savoir des voix. REGARDS D'HOMMES: - Jean Céard. Listes de femmes savantes au XVIe siècle. - Brenda Hosington. Learned ladies : éloges de l'anglaise savante (1550-1558). - Nicole Jacques-Chaquin. La curiosité sorcière : représentations du désir féminin du savoir chez les démonologues (XVIe-XVIIe siècles). - Sophie Houdard. Possession et spiritualité : deux modèles de savoir féminin. - Philippe Salazar. Elizabeth à Descartes : "Etre mieux instruite de votre bouche". - Jean-Charles Darmon. La fontaine et le savoir des muses. DISCOURS DE FEMMES/PORTRAITS: - Eliane Viennot. Ecriture et culture chez Marguerite de Valois. - Chantal Morlet Chantalat. Parler du savoir, savoir pour parler : Madeleine de Scudéry et la vulgarisation galante. - René Démoris. Ecriture féminine en Je et subversion des savoirs chez Mme de Villedieu (les mémoires d'Henriette-Sylvie de Molière). - Emmanuel Bury. Madame Dacier. - Ralph Heyndels. Le cogito du néant : Jeanne Guyon dans l'épistémologie cartésienne. - Elisabeth Lavezzi. Catherine Perrot, peintre savant en miniature : Les leçons royales de 1686 et de 1693. - Henriette Goldwyn. Journalisme polémique à la fin du XVIIe siècle : le cas de Mme du Noyer.